
Gwenola Le Naour est maîtresse de conférences en science politique à Sciences Po Lyon et chercheuse à l'UMR-5206 Triangle, rattaché au CNRS Sciences humaines et sociales. Politiste et sociologue, elle travaille notamment sur les mobilisations des populations contre les pollutions dans le couloir de la chimie, au sud de Lyon, depuis les années 1960.
Depuis deux ans, elle étudie également la mobilisation citoyenne contre la pollution aux substances perfluorées (PFAS) dans le Rhône et en Auvergne-Rhône-Alpes, notamment au sein de l'étude de biosurveillance PERLE, accompagnée par l'Institut écocitoyen de Fos-sur-Mer, et de l'étude épistémologique ASTEROPA, portée par le département Prévention Cancer Environnement du Centre Léon Bérard.
Alors que les industriels Arkema et Daikin seront interrogés par le tribunal judiciaire de Lyon ce mardi 28 mai, suite à un référé environnemental déposé par la Métropole, et qu'une proposition de loi visant à interdire les PFAS est en ce moment examinée par le Parlement, Gwenola Le Naour nous propose une lecture de l'état du débat public sur les PFAS.
La Tribune - Depuis environ deux ans, les PFAS sont sous le feu des projecteurs en région lyonnaise, tant en matière d'accumulation des connaissances que d'actions contre les rejets de ces molécules dans l'environnement : qu'est ce qui a fait prendre de l'ampleur à ce sujet, jusqu'alors tapis sous les radars ?
Gwenola Le Naour - Je travaille depuis plusieurs années sur le couloir de la chimie lyonnais et avec Emmanuel Martinais (ndlr : chercheur à l'École Nationale des Travaux Publics de l'État (ENTPE) et membre de l'UMR CNRS Environnement, ville, Société), nous nous demandions pourquoi la Vallée de la chimie restait à l'écart de ces sujets...
Par exemple, une grande enquête en santé environnement, appelée « Fos Epseal », a été réalisée dans le bassin de Fos-sur-Mer entre 2015 et l'année dernière. Nous nous étonnions, parce que le territoire du sud de Lyon est également très pollué et beaucoup de choses étaient assez peu prises en compte par les autorités des territoires.
D'où des questions de recherche sur « comment se fait-il que les gens ne se mobilisent pas ? ». Il y a plusieurs hypothèses possibles. L'une concerne les stratégies patronales qui ont été mises en place pour limiter au maximum les risques de contestation, ou « prévenir les erreurs de communication ». Mais c'est une hypothèse qui n'est pas complètement validée.
Depuis, le documentaire réalisé par Martin Boudot pour l'émission Vert de rage, diffusé en 2022, a marqué le grand public et déclenché une mobilisation. Cette enquête a en effet rendu visible une pollution invisible. Elle a matérialisé quelque chose et les gens sont tombés de haut, parce qu'ils avaient confiance en Arkema. Beaucoup étaient persuadés que Martin Bourdot ne trouverait rien, ou assez peu de pollution.
Derrière, les journalistes du Monde et de plusieurs rédactions européennes préparaient également leur article cartographiant les PFAS. Ce n'est pas le même type de journalisme, mais ils avaient tous deux bien l'intention de mettre en avant que Pierre-Bénite était un « hot-spot ». Toutes ces enquêtes journalistiques ont rendu visible un problème qui était déjà là. Elles ont fait prendre conscience aux populations qu'elles vivaient sur un territoire massivement pollué.
La Tribune - De nombreux habitants, des citoyens, des collectifs, se sont depuis emparés de ces questions, devenant en quelque sorte des experts « profanes » en prélevant des échantillons d'eau, de sols, et en les faisant analyser par des laboratoires étrangers. Comment trier et proposer une information claire dans ce spectre immense de connaissances de plusieurs origines ?
Gwenola Le Naour - Dans le cadre des projets Perle et Asteropa, nous travaillons à partir de la littérature scientifique, donc des documents qui ont été publiés ou qui émanent d'institutions réglementaires comme le Centre international de recherche sur le cancer (CIRC) ou l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (ANSES).
Ensuite, dans un cadre plus large de co-construction de la recherche, l'idée est aussi de prendre en compte la diversité des savoirs, académiques, universitaires, mais aussi des populations.
Par exemple, au sud de Lyon, des collectifs comme « Ozon l'eau saine » prélèvent de l'eau, de la terre, et font analyser ces échantillons en laboratoire. C'est de la recherche participative, réalisée auprès de chercheurs quant à eux déjà spécialisés.
Faire la distinction entre « savoirs profanes » et « académiques » est certes pédagogique, mais cela peut aussi renvoyer à l'idée que ces savoirs profanes ne sont pas aussi consistants que les savoirs académiques. Sachant que ces savoirs canoniques possèdent eux-aussi des biais et des incertitudes : dont celle de la robustesse statistique des données de santé à l'échelle des territoires, là où il n'y a pas toujours assez de données statistiques.
La Tribune - La région lyonnaise compte deux grands producteurs de ces molécules perfluorées, à savoir Arkema et Daikin : comment ont évolué leurs positions et leurs discours depuis plusieurs années ? Quelles sont leurs stratégies de « gestion de crise » aujourd'hui ?
Gwenola Le Naour - Daikin ne communique pas. Arkema, c'est plus compliqué. Je pense qu'ils ont cru, au départ, que s'abriter derrière la Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DREAL) allait suffire. Mais cela ne fonctionne pas. Ils ont depuis autorisé des journalistes à venir filmer dans l'entreprise et répondent aux questions des médias. De même, leur posture a évolué, parce qu'ils ont fini par reconnaître en partie le problème en recommandant de ne pas consommer les fruits et les légumes des potagers situés autour du site.
Étant donné l'ampleur de la situation et le fait que nous soyons dans un « feuilleton » repris dans la presse locale et nationale, avec une narration, il n'était plus tenable pour Arkema de ne pas communiquer. Surtout, les services de l'Etat et la Métropole ont fini par s'agacer de leur posture.
La Tribune - D'autres entreprises utilisent quant à elles des PFAS dans leur production. Par exemple, l'usine Tefal de Rumilly (Haute-Savoie) utilise à ce jour le PTFE, un PFAS a priori non dangereux en cas d'utilisation normale des produits, mais dont l'innocuité « absolue » semble tout de même faire débat. En parallèle, le groupe finance en partie une ligne de traitement de l'eau au charbon actif, ce qui pourrait être la première application française du principe de « pollueur payeur » appliqué aux PFAS. Que signifie selon vous cette position de l'industriel ?
Gwenola Le Naour - Cela fait partie d'une politique. Tefal a intérêt à faire cela : ils ont devancé l'appel en étant « mieux disant » que leurs concurrents. Mais cela traduit aussi une inquiétude : toute leur communication s'appuie en ce moment sur le fait que leurs produits seraient « sains et sûrs », alors qu'il y a des questionnements.
La Tribune - Le député écologiste Nicolas Thierry, auteur de la proposition de loi visant à interdire les PFAS en ce moment étudiée par le Parlement, dénonce la posture du Groupe Seb consistant, selon lui, à « opposer les emplois à la santé » : est-ce une stratégie courante ?
Gwenola Le Naour - En 1979, une mobilisation a eu lieu au sud de Lyon concernant une substance qui s'appelle l'acroléine, qui s'est finalement avérée non cancérogène. Mais il y avait d'autres problèmes, dont une pollution du Rhône en 1976. Là-dessus, une très grande mobilisation a eu lieu pendant trois ans. A la fin, c'est la menace d'un licenciement qui a fini par faire plier les personnes mobilisées.
C'est une stratégie extrêmement classique et le but des industriels est d'enrôler les salariés avec eux. Cela fonctionne rarement, mais Tefal semble avoir réussi à le faire en partie cette fois-ci.
La Tribune - Certains acteurs, dont la CGT, ou encore un groupe américain de conseil aux investisseurs (IIHC), ont déjà comparé la découverte de la pollution aux PFAS à celle de l'amiante, dont le scandale a éclaté dans les années 1990 : y a-t-il ici matière à comparaison ?
Gwenola Le Naour - Cette comparaison, je l'ai surtout entendue de la bouche de syndicalistes mobilisés sur l'amiante. C'est une image assez parlante, même si l'affaire de l'amiante reste assez différente.
D'abord, l'amiante est une matière cancérogène reconnue depuis les années 1950. C'est une substance sans seuil : si vous êtes exposé cinq minutes à une fibre d'amiante, vous pouvez déclarer un cancer dans trente ans. Sur les PFAS, nous disposons comparativement de beaucoup moins de connaissances.
Pour autant, je trouve cette comparaison très intéressante et assez parlante sur la reconnaissance des expositions et de leurs effets sur la santé pour qu'il y ait un suivi post professionnel des salariés. Et pour les populations exposées, notamment dans les territoires où il y a de fortes concentrations dans l'air, dans le sol et dans l'eau, il faut mettre en place des dispositifs de suivi, mais aussi de prévention des risques.
En ce moment, ce n'est pas le cas pour les PFAS. Nous n'avons pas les moyens juridiques de le faire, notamment parce qu'il n'y a pas de reconnaissance de maladie professionnelle liée à l'exposition au PFOA par exemple. C'est un problème.
La Tribune : Peut-on parler de « crise » des PFAS, ou s'avance-t-on plutôt vers un changement de paradigme durable ? Quelles sont les spécificités de cette affaire ?
Gwenola Le Naour : Sur la « spécificité » des PFAS, c'est d'abord qu'il y en a partout : dans les biens de consommation courante, dans les sols, dans l'air, mais pas avec la même concentration bien sûr.
Nous sommes, je pense, au début d'une prise en charge publique du problème, à plusieurs échelles. Il y aura certainement une législation au niveau européen, parce qu'il y en a déjà aux Etats-Unis et dans certains pays d'Europe. De même, la France travaille aussi sur le sujet.
Nous sommes dans un moment de crise chronique, dans un problème public qui s'inscrira peut-être dans un temps-long, ou bien dans un temps-court, comme pour l'acroléine.

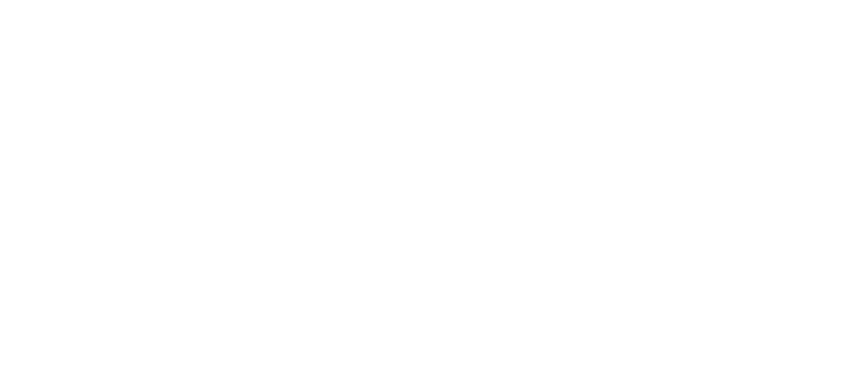
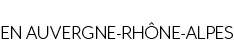
 Surtourisme : dans « la Venise des Alpes », le va-et-vient des valises excède les habitants et interpelle les élus
Surtourisme : dans « la Venise des Alpes », le va-et-vient des valises excède les habitants et interpelle les élus

Il n'y a actuellement aucun commentaire concernant cet article.
Soyez le premier à donner votre avis !