
[Article mis à jour le 29 mai 2024 à 9 h 26 avec l'ajout de la réaction de la Communauté de communes Rumilly Terre de Savoie]
En France, qui financera la dépollution de l'environnement aux molécules chimiques perfluorées ? La question est cette semaine au cœur de plusieurs actualités. Et à Lyon, elle résonne tout particulièrement : le sud du Rhône figure en effet parmi les tout premiers « hot-spots » de la pollution de l'environnement (eau, air, sols) aux PFAS, ces composés chimiques très résistants, au nombre d'au moins 4.000 dans le monde et dont certains (PFOA, PFOS) sont classés cancérogènes par le Centre international de recherche sur le cancer (CIRC, organe de l'OMS).
Produits artificiellement, utilisés pour fabriquer des produits du quotidien résistants à la chaleur (ustensiles de cuisine, combinaisons anti-inflammables, etc), les PFAS seraient, à différents degrés, massivement présents dans l'environnement.
Ainsi, en Auvergne-Rhône-Alpes, près de 40 % des 135 premières Installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE) inspectées par les services de l'Etat en début d'année rejetaient des eaux contaminées à un spectre de 20 PFAS, à des niveaux « hétérogènes », mais bien souvent supérieurs à la future norme européenne, qui s'appliquera dans l'Hexagone en 2026.
Face à l'ampleur de la situation et la montée en puissance d'une mobilisation de la société civile, plusieurs leviers d'actions ont petit à petit été enclenchés sur les plans judiciaire, politique, mais aussi sanitaire (via des arrêtés préfectoraux interdisant les rejets aqueux de certains industriels) ou encore en matière de recherche épidémiologique.
Cela, afin d'avancer dans l'établissement, peu à peu, de responsabilités, alors que le sujet reste particulièrement complexe étant donné la diversité des sous-familles de PFAS.
La Métropole de Lyon, qui finance plusieurs actions depuis deux ans, souhaite notamment aller plus loin sur la prise en charge de la dépollution de l'eau par les industriels responsables, là où plus de 166.000 habitants de la Région consommaient encore une eau potable non conforme à la future réglementation, relevait l'Agence régionale de santé (ARS) en janvier dernier.
Le Grand Lyon a ainsi engagé une action en Justice en mars dernier contre les deux producteurs de perfluorés présents dans la Vallée de la chimie, Arkema et Daikin. Cela, en déposant un référé au civil dans l'objectif d'ordonner une expertise sur les rejets aqueux de PFAS dans le Rhône. Et ainsi identifier des responsables, dans l'idée d'aller vers une traduction concrète du principe de « pollueur-payeur », planant sur cette affaire depuis environ de deux ans.
À Lyon, la Métropole recourt à la Justice
C'est que la facture est particulièrement salée pour les autorités locales. Pour le Grand Lyon, la note est estimée à 6 millions d'euros d'investissements pour installer des filtres au charbon actif sur ses stations de pompage de l'eau, mais aussi créer une nouvelle canalisation entre les réseaux nord et sud, afin de « diluer l'eau » et ses substances chimiques. Des coûts auxquels devront s'ajouter 500.000 euros de frais de fonctionnement annuels pour changer les filtres.
« Nous prévoyons tout cela, mais qui doit payer ? », interroge à ce titre Pierre Athanaze, vice-président de la collectivité de 1,5 million d'habitants, élu à la gestion des risques. « Sont-ce les contribuables grand lyonnais ? Les consommateurs ? Ou les industriels qui ont pollué ? »
Après un premier report, l'audience à laquelle sont convoqués les deux industriels se déroulera finalement ce mardi 28 mai au tribunal judiciaire de Lyon. Elle pourrait déjà offrir de première réponses aux autorités locales, sachant que « pour l'instant, avec Arkema, la situation reste bloquée », soulignait Pierre Athanaze la semaine dernière.
« Il a fallu des mois pour organiser la rencontre entre la direction générale d'Arkema France et le Président de la Métropole, tout cela pour nous dire qu'ils ne voulaient pas payer. Raison pour laquelle nous sommes partis vers ce recours », ajoute l'élu écologiste.
Sachant que bon nombre d'acteurs ont également le regard tourné vers la situation outre-Atlantique : aux Etats-Unis, selon France 3 Auvergne-Rhône-Alpes, le groupe Arkema a par exemple provisionné quelque 109 millions de dollars la semaine dernière afin de régler un litige à l'amiable sur les PFAS avec le Département de la protection de l'environnement du New Jersey.
Un élément supplémentaire allant dans le sens d'une « responsabilité » qui serait désormais reconnue à demi mot par le chimiste, selon Pierre Athanaze. Sachant qu'en parallèle, certains industriels emploient d'autres stratégies.
À Rumilly, Tefal pourrait financer la dépollution de l'eau
Ainsi, la situation de la commune de Rumilly, située à 20 kilomètres d'Annecy, en Haute-Savoie, serait un « cas d'école » selon le député EELV de Gironde Nicolas Thierry, rapporteur d'une proposition de loi visant à interdire l'ensemble des PFAS en France à horizon 2026.
La commune accueille notamment le principal site de production de l'entreprise Tefal (Groupe Seb) en France, qui y fabrique des ustensiles de cuisine. Usine en partie responsable par le passé, indique l'ARS Auvergne-Rhône-Alpes, de la pollution au PFOA (interdit depuis 2020) et d'autres PFAS de plusieurs champs captant d'eau potable aux alentours du site.
Depuis, un système de filtration de l'eau au charbon actif a été financé par l'Etat, le Département et la Communauté de communes Rumilly Terre de Savoie à hauteur de 1,5 millions d'euros, afin de rétablir la distribution de l'eau potable.
Les coûts de fonctionnement sont quant à eux évalués à 400.000 euros par an, et sont pour l'heure pris en charge par la Communauté de communes, bien que Tefal ait annoncé par voie de presse, comme l'indique le média Vert, souhaiter les prendre en charge. Ce qui serait l'une des premières application du principe de « pollueur-payeur » pour les PFAS dans l'Hexagone.
Pour l'heure, ces frais « représentent des coûts additionnels pour la collectivité et pour rééquilibrer le budget, sont compensés par des recettes, essentiellement constituées des abonnements de usagers du service de distribution de l'eau », indique également la collectivité territoriale.
Une situation que les élus écologistes de la Région jugent « ambiguë » : en effet, l'industriel utilise toujours un perfluoré de la famille des polymères, le PTFE, présenté comme « non-dangereux » par le groupe SEB, mais dont l'innocuité absolue, en cas d'utilisation non-conforme des produits, ferait débat dans le champ de la recherche scientifique.
Le député du Rhône Cyril-Isaac Sibille (Renaissance), auteur d'un rapport d'information sur les PFAS remis au gouvernement en janvier dernier, indiquait à ce titre que « selon certaines études, les fluoropolymères (ndlr : dont fait partie le PTFE) peuvent rejeter des substances d'auxiliaires de polymérisation (émulsifiants, dispersants, surfactants), des monomères non polymérisés, (dits « impuretés »).
« La question de leur évolution physique ou chimique à long terme, hors conditions nominales de mise en œuvre, constitue également un point de débat », ajoutait le parlementaire.
Contacté à ce sujet, le Groupe Seb, qui a réalisé un chiffre d'affaires de 8 milliards d'euros en 2023 (+0,6 %) et un bénéfice net de 386 millions d'euros (+22,1 %), n'a pour l'heure pas répondu à nos sollicitations.
Lors de la dernière assemblée générale du groupe, le 23 mai dernier, son président directeur général, Thierry de La Tour d'Artaise, aurait déclaré que la « priorité a toujours été évidemment et est toujours la santé de nos collaborateurs et de nos consommateurs », indique l'Agence France Presse.
Une proposition de loi devant le Sénat ce jeudi
Selon la conseillère régionale écologiste Fabienne Grébert, cette réaction de l'industriel serait en tout cas la traduction d'un « artefact juridique », visant à se protéger de toute mise en accusation.
« A Rumilly, nous sommes plutôt dans le black-out, y compris au sein des organisations syndicales, parce que Tefal ferme ses portes », ajoute l'élue régionale d'opposition, également conseillère municipale et communautaire à Annecy.
Fin mars dernier, à quelques jours de la présentation de la proposition de loi écologiste à l'Assemblée nationale, le Groupe Seb avait notamment indiqué dans La Tribune Dimanche le risque que ferait peser le texte sur ses salariés. Quelques jours plus tard, le syndicat Force ouvrière appelait également à manifester devant le Palais Bourbon afin de retirer les ustensiles de cuisine du texte, ce qui a par la suite été voté par amendement.
Ainsi, les débats se sont focalisés sur autour du niveau de connaissances scientifiques : faut-il réglementer l'ensemble des PFAS selon le principe de précaution, ou chaque molécule au cas par cas ?
De même, une dualité semble avoir été instaurée par l'industriel entre « risques » d'un côté, et « emplois » de l'autre. Une stratégie jugée « classique » par Gwenola Le Naour, politiste à Sciences Po Lyon (lire notre entretien publié ce jour).
Interrogée sur la posture du groupe industriel, Fabienne Grébert estime également que « soit Tefal se dit qu'il change son outil industriel, l'adapte, et se met aux normes d'un marché mondial qui de toute façon va devoir se passer des PFAS, parce que nous n'avons plus les moyens de polluer nos nappes phréatiques, nos eaux de surface, compte-tenu de l'évolution du dérèglement climatique. (...) ».
« Soit, ce que nous craignons, c'est que Tefal soit dans une logique financière d'aller s'implanter là où la production est moins chère et essaye de gagner deux ou trois années à Rumilly jusqu'au maximum possible, jusqu'à l'inadaptation de l'outil industriel à la stratégie de l'entreprise. Nous avons besoin d'être rassuré, que Tefal soit dans une logique d'innovation », complète Fabienne Grébert.
L'élue d'opposition demande également que des études épidémiologiques soient réalisées à Rumilly et sur tous les sites industriels utilisant des PFAS, « en miroir de ce que font les services de l'Etat et la Métropole de Lyon dans le Rhône » avec les études Perle et Asteropa.
De son côté, Véronique Riotton, députée Renaissance de Haute-Savoie, indiquait également à nos confrères de France 3, le 3 avril dernier, qu'il « est urgent de mieux connaître les conséquences et surtout, d'aider les industriels à trouver des alternatives ».
Vers une interdiction dans certains usages en 2026 ?
Surtout, ces différents éléments alimentent les débats en cours au niveau national : le groupe Les Ecologistes a en effet déposé il y a plusieurs semaines une proposition de loi visant à interdire l'ensemble des PFAS à horizon 2026. Elle porte non seulement sur l'interdiction des rejets, mais aussi de l'utilisation de toute substance perfluorée.
Le texte, dont ont été exclus les ustensiles de cuisine lors de sa première lecture à l'Assemblée nationale en avril, sera présenté au Sénat ce jeudi 30 mai, après quelques modifications en commission la semaine dernière. Il devra donc ensuite entamer une deuxième boucle au Parlement.
Selon le député Nicolas Thierry, à l'origine du texte : « Il était fondamental et extrêmement important de traduire le principe de pollueur-payeur qui, en réalité, même si on l'évoque souvent pour les pesticides ou la pollution chimique, n'est jamais appliqué très concrètement ».
Pour cela, le député propose d'inscrire un dispositif « au volume » : à savoir taxer tout industriel, tout producteur ou toute Installation classée pour la protection de l'environnement (ICPE) qui rejette des PFAS dans l'environnement, à hauteur de 100 euros pour 100 grammes de PFAS. La somme de cette taxe serait ensuite dirigée vers les six Agences de l'eau, qui subventionneraient les collectivités territoriales afin de dépolluer les sites concernés.
Pour autant, cette manne financière « ne serait pas suffisante pour couvrir les frais de dépollution », concède le député. « Mais il était important, au regard du rapport de force dont je dispose à l'Assemblée, d'arriver à cranter, à inscrire ce principe dans la loi ».
À titre d'exemple, le coût de dépollution des sites contaminés aux PFAS en Europe a été estimé à 238 milliards d'euros par le chercheur norvégien Hans Peter Heinrich Arp, cité par le député du Rhône Cyril Isaac-Sibille (RE) dans son rapport remis au gouvernement en janvier dernier.
En parallèle, le député Cyril Isaac-Sibille recommande une autre forme de financement : la mise en place d'un « fonds PFAS » pour la dépollution des sites, financé en parti par les acteurs privés, mais aussi publics.
Des échanges ont à ce titre eu lieu entre les différents groupes parlementaires. Pour Nicolas Thierry, il s'agit là « de définir la tuyauterie » : « Est-ce un fonds ? Est-ce de l'argent taxé qui part aux Agences de l'eau ? Le point principal est que les industriels contribuent. Je craignais en revanche, avec le fonds public - privé, que les instruments ne servent à nouveau les intérêts du privé », complète l'auteur de la proposition de loi.
Tandis que de son côté, Cyril Isaac-Sibille pointait le 27 mars, en commission : « Vous souhaitez taxer les industriels sur la base de leurs rejets. Moi, j'entends que l'urgence, pour nos concitoyens, est de les faire cesser, ce à quoi nous sommes parvenus dans le Rhône ».
Propos alors complétés par le député de la 6e circonscription du Rhône, Gabriel Amard (LFI/Nupes) : « Plutôt que de l'adosser aux rejets, il faudrait faire reposer la redevance sur les quantités d'eau prélevées par les industriels sur les réseaux d'eau potable ou en milieu naturel.
« En effet, grâce à la proposition de loi, il y aura de moins en moins de rejets polluants, alors que nous aurons besoin de fonds substantiels pour financer les actions de dépollution que mèneront les autorités organisatrices pendant des décennies », soulevait le député.
Pour sa part, Nicolas Thierry nous indique aujourd'hui s'attendre, à ce que « la masse d'informations sur les PFAS ne fasse que grandir dans les prochaines années ».
« Ma conviction, c'est que ces données vont nous révéler l'aspect grave et systémique de cette pollution. Si à ce moment-là, nous avons déjà un principe avec un principe de taxe qui est en place, ce ne sera pas très difficile de gagner le niveau de taxation », ajoute Nicolas Thierry.
Articulation de la législation française avec l'échelon européen, structuration du principe de pollueur-payeur : les débats vont se poursuivre au Sénat ce jeudi 30 mai avec, en toile de fonds, le spectre des investissements à réaliser afin de caractériser ces polluants, leurs effets, mais aussi étayer une stratégie de dépollution.

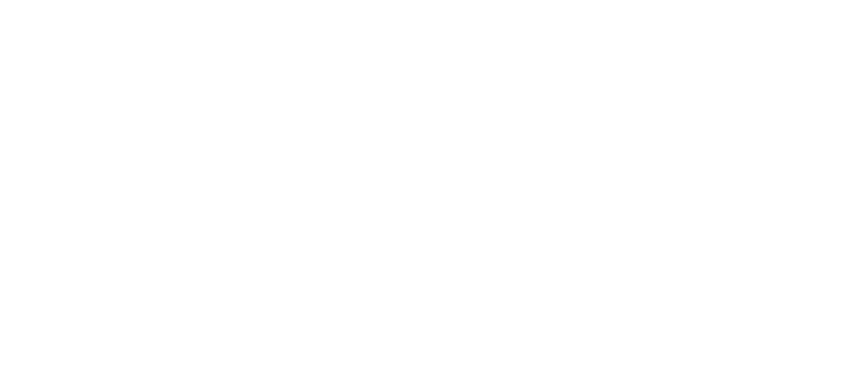
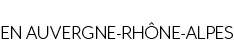
 Surtourisme : dans « la Venise des Alpes », le va-et-vient des valises excède les habitants et interpelle les élus
Surtourisme : dans « la Venise des Alpes », le va-et-vient des valises excède les habitants et interpelle les élus

Sujets les + commentés