
Premier producteur indépendant d'éolien en France, le canadien Boralex maille le territoire français avec ses champs d'éoliens, ses fermes solaires et quelques unités de stockage d'énergie. Ce, depuis la mise en service de son premier parc éolien en 2002. La région Auvergne-Rhône-Alpes fait partie de ses cibles privilégiées, avec une activité qui se répartit en deux volets : 174 MW d'énergie solaire et 480 MW d'énergie éolienne produites. Avec, au total, une trentaine de projets développés ou en cours de développement dans leur portefeuille.
Et une ambition : équilibrer la production de ces deux énergies. « Nous aimerions atteindre 50% de production issue du solaire et 50% issue de l'éolien, soit environ 500 MW chacun » , confie François Palmier, responsable régional chez Boralex. Pour y arriver, celui-ci mise notamment sur l'agrivoltaïsme et l'intérêt croissant des industriels pour des approvisionnements locaux en énergie décarbonée.
Développer le photovoltaïque
Cette stratégie serait-elle le fruit du décret pris par le gouvernement début avril pour encadrer cette pratique ? Pas vraiment.
« Il n'y aura pas d'explosion d'agrivoltaïsme, estime François Palmier. La tendance, lancée il y a deux ans, va se poursuivre au même rythme chez nous comme nos confrères. Cette législation vient juste définir ce qu'est l'agrivoltaïsme et l'encadrer, mais il reste encore des zones d'ombre concernant l'agri-compatibilité des projets. Les chambres d'agriculture ont neuf mois pour établir un document cadre pour chaque département. »
La société canadienne annonce déjà la sortie de certains projets phares cette année, en Auvergne-Rhône-Alpes. François Palmier cite comme exemple la réalisation d'une ombrière agrivoltaïque sur une plantation de kiwi à Saint-Didier-sous-Aubenas, en Ardèche. « Il y aura une technologie de traqueur innovante. Avec cette solution, nous rendons d'abord service à l'agriculteur puis nous produisons de l'énergie. »
Déjà présente dans l'Allier, la Haute-Loire et l'Ardèche, l'entreprise canadienne souhaite s'implanter dans l'est de la Région en renforçant son positionnement en Auvergne mais également dans l'Ardèche et la Drôme où l'ensoleillement et les cultures sont importantes.
Autre cible visée pour doper sa production solaire : les industriels en quête de solutions pour décarboner leur appareil productif. « Ils ont besoin d'électricité verte et viennent nous voir pour sécuriser des contrats d'approvisionnement. Et pour cela, ils sont en recherche de solution locale avec une production à l'échelle départementale ou régionale », constate le responsable régional.
Parmi les projets en cours de développement, on peut citer celui avec le groupe pharmaceutique Fareva, installé en Haute-Loire. Ce parc vise une puissance avoisinant 49 MWc, à proximité de l'usine.
Cette volonté de se renforcer sur le photovoltaïque fait également écho à l'objectif du SRADDET (schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires) fixé par la Région Auvergne Rhône-Alpes, et qui vise 6,5 GW de production photovoltaïque en 2030. Et ce, alors que celle-ci s'élevait à 1,5 GW en 2021.
Mais ces objectifs dépendront aussi de l'accueil qui sera fait à ces projets par les élus, les associations mais également les citoyens et la DREAL.
Associations, citoyens, élus... L'enjeu de l'acceptation
« En 2016, nous faisions face à beaucoup de fake news sur les éoliennes : elles n'étaient actives que 10% du temps, il y avait de la radioactivité dans les fondations, etc. Aujourd'hui, tout le monde reconnaît leur efficacité et leur capacité de production », confie François Palmier sans nier le poids des élus, de la société civile et des associations.
« Il y a encore des problèmes d'usage avec cette idée que : je n'en veux pas chez moi mais c'est bien chez les autres. On ne peut plus raisonner de cette manière aujourd'hui. Il faut être a minima autosuffisant à l'échelle départementale et même un peu loin, régionale. » Et ce, afin d'être cohérent avec les enjeux d'adaptation au changement climatique, la décarbonation de l'industrie et la politique de réindustrialisation du gouvernement.
Une vision qui ne semble pas partagée avec toutes les associations environnementales qui pointent parfois des effets sur la biodiversité, les citoyens mais aussi certains élus. En mars dernier, le président de la Région Auvergne Rhône-Alpes, Laurent Wauquiez annonçait ainsi arrêter net le financement de nouveaux projets éoliens via le fonds d'investissement public-privé OSER. « Un mauvais signal envoyé » pour François Palmier dont la société n'est pas touchée par cette décision, assure t-il.
Le poids du politique peut pourtant peser dans la balance dans certains cas. De même que l'avis des citoyens et des associations environnementales, même si les résultats finaux ne sont pas toujours ceux qu'on attend.
En 2005, la société met en production le parc d'Ally-Mercoeur, en Haute-Loire. Quinze ans plus tard, l'entreprise projette de l'agrandir en ajoutant 11 éoliennes au nord. Le préfet de Haute-Loire, Nicolas de Maistre a pris un arrêté empêchant cette extension, confirmée par le conseil d'Etat en août 2023. Cependant 7 éoliennes supplémentaires ont pu être installées au sud.
« C'est un exercice plutôt bien fait, mais qui n'est pas représentatif de toute le territoire et qui est surtout consultatif », résume le responsable régional. « En France, on met tout le monde autour de la table : la DREAL, l'armée, les associations, les citoyens... On essaie d'obtenir un consensus avec le maximum d'acteurs. »
Une méthode qui possède ses avantages, et trouve aussi ses limites selon lui : « On perd en compétitivité par rapport aux pays étrangers, avec ces crispations si nous n'arrivons pas à les détendre, surtout dans un contexte de réindustrialisation de la France et des territoires ».
Les communes et les citoyens deviennent aussi investisseurs
Si certains dossiers peinent à voir le jour, d'autres reçoivent un véritable soutien des territoires. Et même un soutien financier.
Le modèle économique de Boralex s'appuie sur différentes stratégies. « On peut financer en fonds propre de petits projets ou aller chercher de la dette bancaire à hauteur de 80% auprès d'instituts nationaux », détaille François Palmier, qui constate le développement d'une nouvelle tendance, l'investissement des collectivités.
« De plus en plus de territoires veulent s'intégrer à nos projets comme pour le parc éolien d'Auzelon (Allier) en cours d'étude. Une perspective en cours d'établissement », confie l'intéressé.
Autres cibles d'investisseurs possibles : les citoyens. « Pour le parc solaire La clé des champs dans le Puy en Velay, nous avons levé 800.000 euros sur 11 millions d'euros d'investissement total, auprès d'investisseurs du département en 15 jours, avec beaucoup de petits épargnants », révèle t-il. « Dès que nous avons mis l'annonce en ligne, mon téléphone n'a pas cessé de sonner. D'autres personnes auraient aimé investir mais nous avions déjà ouvert 40% du capital, c'est énorme. »
Un modèle de financement qui, à l'instar de celui des communes, pourrait lui aussi faire son chemin, les Français cherchant à donner du sens à leur épargne et identifier ce qu'ils financent avec leur épargne. Et ces projets, en plus de produire une énergie renouvelable, contribue à la création de métier dans leur zone géographique.
Un approvisionnement éthique et français, demain ?
Le responsable revient également sur un sujet d'importance : la disparition des producteurs de panneaux solaires en France et la volonté, mise en avant par l'entreprise, d'un approvisionnement éthique.
« Nous nous approvisionnons, en partie, avec des panneaux américains mais aussi avec des panneaux solaires chinois. Nous sommes obligés car nous avons perdu les producteurs français que nous avions. Nous nous interdisons cependant de travailler avec des entreprises qui font travailler les Ouïghours, ce qui nous a obligé à écarter certains fournisseurs. C'est là où notre charte est responsable », développe t-il.
En ajoutant qu'il espère pouvoir, grâce au projet Carbon de Fos-sur-Mer, recourir à une production plus européenne et même français. « A condition que les prix soient compétitifs et le bilan carbone, bon. » A contrario, dans l'éolien, Boralex a majoritairement recours à des composants européens.

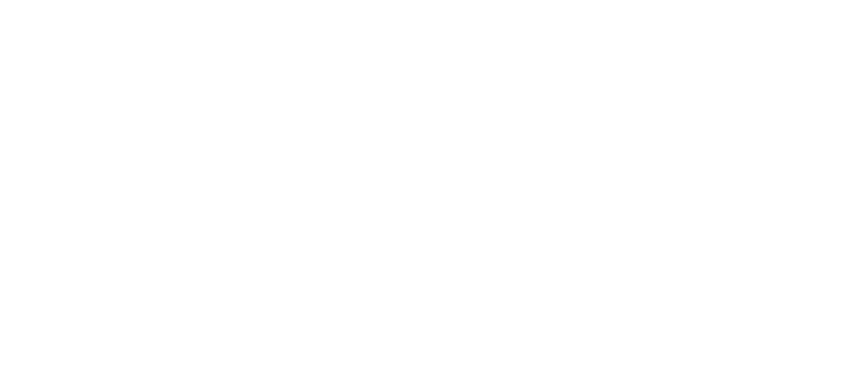
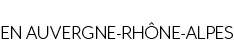
 Surtourisme : dans « la Venise des Alpes », le va-et-vient des valises excède les habitants et interpelle les élus
Surtourisme : dans « la Venise des Alpes », le va-et-vient des valises excède les habitants et interpelle les élus

Il n'y a actuellement aucun commentaire concernant cet article.
Soyez le premier à donner votre avis !