
Nombreux sont les projets de centrales photovoltaïques, de parcs éoliens ou encore de méthaniseurs à fournir les pages des plateformes de crowdfunding comme Lendopolis, Enerfip, Lumo ou encore Lendosphere... Des sociétés qui ont toutes fait le choix de s'aventurer vers le financement participatif d'infrastructures d'énergie renouvelable. Un pari plutôt gagnant, si l'on en croit les chiffres de Lendopolis :
« En 2020, nous réalisions une petite quinzaine de millions d'euros de levées, aujourd'hui, nous sommes à une grosse cinquantaine de millions par an », révèle Aurélien Gouraud, directeur général de la plateforme parisienne.
Avec une évolution forte du montant des campagnes : « En 2015, collecter 100.000 euros était un peu sportif. Aujourd'hui, nous avons réussi à mener une opération locale de 2,6 millions d'euros dans l'Allier, où seuls les habitants du département d'implantation de la centrale et des départements adjacents pouvaient participer ».
Un modèle qui fonctionne particulièrement bien pour les centrales photovoltaïques qui représentent, pour cet opérateur, 80% des projets. Avec une montée en puissance des unités de méthanisation.
Les opérateurs, encouragés à partager le gâteau
Pour comprendre l'ouverture de tel projet à l'épargne des Français, il faut revenir en 2014 où l'Etat réglemente le modèle du crowdfunding, permettant le développement d'un modèle qui met en lien des investisseurs particuliers et des porteurs de projet. Au fil du temps, certaines plateformes se spécialisent sur des segments comme l'agriculture, la technologie ou encore les énergies renouvelables.
« Ces plateformes facilitent la mise en oeuvre des campagnes de levée de fonds, tant pour les investisseurs que pour les porteurs de projets, en "packageant" le montage financier », souligne Grégory Faillenet, directeur de BPCE Energeco, filiale de BPCE Lease.
Mais c'est surtout l'intégration d'une bonification du prix d'achat dans les appels d'offres de la Commission de la régulation de l'énergie (CRE), en 2017, qui va pousser le développement de ce financement. En effet, le dispositif de soutien aux installations photovoltaïques de grande puissance repose sur des appels d'offres.
« Quand vous développez une centrale solaire en France, l'important est d'obtenir un tarif d'achat de l'électricité intéressant pour votre future centrale » , introduit Aurélien Gouraud. « Si les centrales de petites dimensions et capacités sont soumises au tarif du guichet ouvert, les projets de grande capacité doivent répondre à des appels d'offres ».
Tous les trimestres, la CRE lance un appel d'offres permettant à plusieurs acteurs et projets d'être sélectionnés. Dans ce cadre, les candidats dont le projet est assez mature, c'est-à-dire, disposant des autorisations et prêts à lancer la construction, proposent un prix d'achat. « Les mieux-disants, c'est-à-dire, les plus compétitifs en prix, remportent la mise », poursuit le directeur général de Lendopolis.
En 2017, l'Etat décide que les « opérateurs s'engageant à intégrer une part de financement participatif dans le projet, bénéficieront d'une bonification de leur complément de rémunération qui était non négligeable. On parlait de 2 à 3 euros du MWh », renchérit, le directeur général de BPCE Energeco.
En 2022, la donne change : « Plutôt que d'accorder un financement supplémentaire, qui coûte in fine à la collectivité, il décide d'accorder des points de bonus » à ceux qui proposent ce financement participatif, poursuit Aurélien Gouraud.
Un complément pour les projets plus modestes
Résultat : « On s'est retrouvé avec des projets potentiellement portés par des acteurs de grande dimension, qui n'avaient absolument pas besoin d'argent pour financer leurs projets. Mais ces acteurs avaient pris le parti de candidater, de prendre cette option parce qu'ils y trouvaient historiquement un avantage », analyse le directeur général de Lendopolis.
Pour d'autres projets, de plus petites dimensions, le crowdlending « accompagne le porteur de projet pour l'alléger » sur sa partie de financement, précise Grégory Faillenet. Ces infrastructures sont majoritairement financées par la dette, mais les banques demandent souvent une participation de l'opérateur, à hauteur de 10 à 20%. Une trésorerie que ne possède pas forcément l'entreprise.
« Des acteurs de dimensions modestes, ont alors décidé de faire appel au financement participatif par la suite, pour venir compléter leurs projets et les faire sortir de terre. » Ce modèle leur permet également d'accélérer « le développement de projets car un opérateur qui partage les investissements peut investir dans davantage de projets ».
Car, rappelle Catherine Bouchard, directrice marketing chez Terre et Lac, porteur de projets d'énergie renouvelable : « ce sont des projets qui sont portés sur 30 ans avec l'exploitation. Cela demande une certaine capacité d'investissement ».
De son côté, EDF Renouvelable annonce répondre à une demande des territoires : « La mise en place du financement participatif n'est pas réalisée à la demande d'EDF Renouvelables, mais bien du territoire. Cela constitue un levier significatif afin de répondre à la demande grandissante des particuliers de pouvoir investir dans la transition énergétique de leur territoire, tout en bénéficiant de retombées économiques. »
Un outil pour améliorer l'acceptabilité des projets ?
Au-delà de cet aspect purement économique, certains opérateurs voient dans l'inclusion des populations locales, une sorte de pédagogie et même un facteur d'acceptabilité des projets. Car l'opposition, des citoyens mais aussi d'association de protection de l'environnement, peut freiner voire empêcher des projets.
Si Catherine Bouchard voit plutôt l'acceptabilité des projets comme un travail à effectuer en amont, elle reconnaît encore le besoin de « sensibiliser les populations et les territoires pour soutenir la transition » et l'intérêt du financement participatif comme moyen d'ouvrir un dialogue.
Pour d'autres, il constitue un facteur d'acceptabilité. « L'acceptabilité des projets solaires n'était pas un sujet il y a cinq ans mais le devient, notamment du fait de leur agrandissement. On connaît des tensions et des réfractions aux projets dans l'éolien, qui commencent à se matérialiser peu à peu dans le solaire. Et donc la plupart des acteurs qui se lancent dans de grands projets prennent l'option de faire appel aux riverains pour co-financer le projet », confie Aurélien Gouraud.
Ce, d'autant que les appels d'offres de la CRE prennent en compte les financements participatifs réalisés à échelle locale, c'est-à-dire, au niveau du département d'installation de l'infrastructure et des départements adjacents. Les projets de petite et moyenne dimension « n'étant pas contraints par un appel d'offres, peuvent aller chercher une épargne à Lille, Nantes, Strasbourg ou encore Marseille » , nuance t-il.
Des citoyens qui veulent s'impliquer sur des projets locaux
Et cette solution semble plutôt répondre à leurs besoins. « Pour le parc solaire La clé des champs dans le Puy-en-Velay, nous avons levé 800.000 euros sur 11 millions d'euros d'investissement total, auprès d'investisseurs du département en 15 jours, avec beaucoup de petits épargnants. Dès que nous avons mis l'annonce en ligne, mon téléphone n'a pas cessé de sonner » , confie François Palmier, responsable régional chez Boralex.
Constat identique pour le syndicat Valtom concernant un projet de méthaniseur dans le Puy de Dôme. « Ça a été un succès puisque 130 habitants ont participé au financement à hauteur de 250.000 euros. Nous souhaitons que nos citoyens soient acteurs de la transition écologique et énergétique », souligne Laurent Battut, le président du Valtom.
Sur les plateformes de crowdfunding, on voit en effet des campagnes être complétées en quelques jours. Interrogés sur les raisons qui les poussent à investir sur Lendopolis, les utilisateurs pointent trois raisons principales, confie le directeur général de Lendopolis : « savoir où est fléché et ce que finance leur épargne, financer la transition énergétique et le couple rendement / risque du produit ».
Un produit financier plus attractif mais plus risqué
Et il faut dire qu'au regard du taux affiché par le livret A, produit sans risque, ceux des projets d'énergie renouvelable sont plutôt attractifs.
« C'est beaucoup plus intéressant qu'un livret A, insiste Catherine Bouchard. Quand on parle d'investissement auprès de nos clients, ils savent très bien que ce sera rentable. C'est vraiment gagnant-gagnant. »
Un constat partagé par Grégory Faillenet qui appelle néanmoins à la prudence. « Il ne faut pas négliger le risque. Les résultats annoncés sont liés à la bonne marche du projet et sa rentabilité, donc il ne faut pas oublier que c'est un placement qui a plus de risque qu'un livret bancaire ».
Si aujourd'hui, aucun projet n'aura connu de déroute selon les interlocuteurs précédemment cités, aucun n'écarte le risque qui existe. Ce, d'autant que les financements peuvent intervenir à des stades différents de développement du projet.
« Là où il y a deux ou trois ans, tous les projets se ressemblaient à peu près avec des écarts de 0,5%, on se retrouve aujourd'hui avec des écarts de taux de rendements, avec des produits à 6% comme à 9% et de 12 mois à 5 ans, développe Aurélien Gouraud, alors qu'historiquement, on avait une maturité commune à 4 ans ».
Le directeur général de Lendopolis appelle donc les épargnants et investisseurs à la prudence en prenant le temps d'examiner chaque projet et sa maturité. Car si un certain nombre de projets lancent des campagnes de crowdlending une fois les projets prêts à construire, c'est-à-dire, après avoir obtenu les autorisations, d'autres le font au tout début du projet pour pouvoir le lancer. Ceux-ci sont donc beaucoup moins matures.

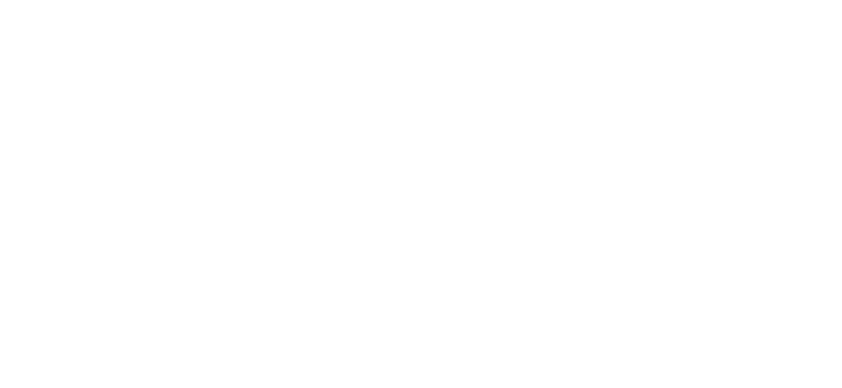
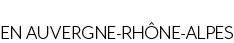
 ZFE : par « pragmatisme », la Métropole de Grenoble rétropédale à son tour sur son calendrier
ZFE : par « pragmatisme », la Métropole de Grenoble rétropédale à son tour sur son calendrier

Il n'y a actuellement aucun commentaire concernant cet article.
Soyez le premier à donner votre avis !