LA TRIBUNE - Comment se portent les créations d'entreprises cette année ? Le contexte actuel, avec la hausse des prix et des taux d'intérêt, a-t-il freiné la forte dynamique en sortie de crise sanitaire ?
Guillaume Pepy : L'envie d'entreprendre reste intacte. Malgré l'inflation, le contexte international extraordinairement tendu et les taux d'intérêt élevés, nous constatons que la création d'entreprises ne faiblit pas. Nous sortons de deux années extraordinaires en 2021 et en 2022, où nous avons vu une explosion des créations d'entreprises. Aujourd'hui, 2023 s'annonce comme une année de consolidation, probablement avec une croissance de 1 à 2 %, sans prendre en compte les micro-entreprises. Je dirais que cela s'explique fondamentalement par deux raisons. La première concerne, en lame de fond, la motivation pour entreprendre. Trois mots reviennent souvent dans la bouche des créateurs et des créatrices d'entreprises : le challenge personnel, l'indépendance et le sens. La deuxième raison concerne la réorientation de l'économie vers le local, les circuits-courts, et toutes les activités à impact. Ce sont autant d'occasions de créer de nouvelles entreprises.
Les taux d'intérêt sont toujours en hausse et empêchent de nombreux prêts, notamment dans l'immobilier. Cela a-t-il un effet sur le montant du prêt d'honneur Initiative France (177 millions d'euros prêtés en 2022), qui vise à renforcer voire remplacer l'apport personnel devant les banques ?
Il est aujourd'hui possible de créer son entreprise en France sans aucun apport personnel. Le prêt d'honneur peut aller jusqu'à 70.000 euros pour des projets très innovants. Pour ceux qui exigent des fonds propres, comme les projets agricoles, cela nécessite parfois 30 à 40.000 euros. La moyenne, en France, est un peu supérieure à 10.000 euros par créateur. Depuis quelques mois, ces prêts sont vus comme beaucoup plus intéressants que par le passé. Il y a deux ans, quand les taux d'intérêts étaient inférieurs, à un point, les prêts à taux zéro étaient moins intéressants. Aujourd'hui, les taux d'emprunt étant entre 4 et 5 %, le taux d'honneur à taux zéro est redevenu très intéressant et nous en sommes très contents. Cela nous permet d'aider plus de personnes.
Les entrepreneurs accompagnés sont-ils plus nombreux cette année ?
Nous observons en tout cas une petite révolution du côté des projets de reprise d'entreprise. Ils ont bondi de presque 25 % en un an. Comment l'expliquer ? La première raison, c'est que dans un moment un peu perturbé, ce type de projet offre un peu plus de sécurité. Les entrepreneurs partent avec une clientèle, une chalandise, un produit, un local, du personnel. Deuxième avantage, la reprise permet de se développer plus vite. Bien souvent, ces projets se lancent en préservant cinq à dix emplois. L'entreprise peut doubler ou tripler sa taille beaucoup plus vite. C'est une tendance de fond des années 2022 et 2023, et qui concerne aussi bien l'agriculture, avec des reprises d'exploitation agricole, que l'artisanat et la petite industrie.
Pourtant, on observe le retour des défaillances d'entreprises, notamment en maturation, avoisinant les niveaux de 2019. Comment les créateurs les appréhendent-ils ?
La principale crainte ne concerne pas les défaillances, mais plutôt l'auto-censure. C'est l'hésitation, l'incertitude, le doute. Les femmes y sont encore plus sensibles, avec la représentation du chef d'entreprise masculin. Tout cela pèse. Les idées sont là, les dispositifs de financement aussi, comme les mécanismes d'accompagnement, mais rien ne peut remplacer la confiance en soi et dans le projet.
Selon une étude réalisée en 2021 par l'IFOP avec la Bpifrance, « 20 % des habitants des quartiers prioritaires de la politique de la ville participaient à la dynamique entrepreneuriale, contre 30 % des français ». Une proportion « en hausse par rapport à celle de 2018, alors à 14 % ». Comment qualifier la situation dans les quartiers populaires ?
C'est moins facile dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville. Les personnes sont moins bancarisées qu'ailleurs, souffrent d'une forme de stigmatisation, doutent d'elles-mêmes, manquent de confiance. Et quand elles créent, ce sont souvent des micro-entreprises, là où elles pourraient monter des organisations plus structurées. L'enjeu n°1, c'est de solidifier le dossier, donner confiance et accompagner. Il faut garder à l'esprit que moins de 20 % des entrepreneurs sont accompagnés en France. Pour ceux qui le sont, le taux de pérennité à trois ans s'élève à 91 %. Il est de 84 % dans le Vaucluse, où nous sommes aujourd'hui.
Quels sont les freins sociologiques ?
L'entreprenariat est indifférent au niveau de diplôme. « Bac -5 », « bac +5 », il n'y a aucune importance, car il faut réunir d'autres conditions pour réussir : la viabilité du projet, et cela n'a rien à voir avec le niveau de diplôme, ou la catégorie sociale. Mais aussi d'avoir en soi la petite pile à combustible : à savoir l'énergie, l'envie de se prouver à soi-même, de relever des défis, de créer du sens autour de soi et pour les autres. Il y a une infinité d'idées autour d'entreprises qui non seulement créent de la richesse, mais font aussi du bien à la société. C'est cela, être une entreprise à impact.
L'Insee relevait en 2020 que les initiatives en quartier prioritaire sont aussi nombreuses qu'ailleurs, mais les montants levés sont moins importants. N'est-ce pas aussi lié à la confiance des investisseurs ?
Cela va dans le même sens. Dans les quartiers difficiles, la dynamique est souvent rabattue à cause de biais cognitifs, de la stigmatisation et du fait que les personnes hésitent à contacter les banques. De l'autre côté, nous avons aussi l'exemple, près d'Avignon, d'un ancien sportif professionnel, auparavant membre de l'équipe de France de rugby, qui s'est vu refusé une demande de prêt de 6.000 euros par une banque pour créer un club sportif. Ce sont, à mon sens, des réflexes de manque de confiance.
Selon Hisham Bourohi, directeur d'Initiative Terres de Vaucluse, l'une des 206 antennes de votre réseau, un accompagnement spécifique constitue « la brique manquante » entre les habitants des quartiers de la politique de la ville et les dispositifs ordinaires. Il invite à « créer des ponts » entre les deux, sans lesquels « cela ne marchera pas ». Comment les construire concrètement ?
Nous souhaitons et faisons en sorte que le droit à l'entreprenariat soit ouvert à tous et partout. Pourtant, pas un projet, ni un créateur, ni un lieu ne se ressemble. D'où la nécessité d'un accompagnement personnalisé, grâce à nos 20.000 bénévoles et 1.000 salariés. Ce qui fait la différence, c'est moins le financement que l'accompagnement. D'ailleurs, dans les quartiers sensibles, nous avons interrogé à la fin de l'année dernière 70 entrepreneurs soutenus dans nos réseaux. La moitié d'entre eux nous disent qu'ils auraient aimé être plus ou mieux accompagnés. C'est notamment le cas devant les banques, à la recherche de financement, ou dans l'intégration à l'écosystème local. La mention exacte, c'est qu'ils « chercheraient davantage de conseils ou prendraient plus de temps pour trouver des sources de financement complémentaires ». Autrement dit, le principal risque pour un jeune entrepreneur, c'est l'isolement.
Ces enjeux d'accessibilité se posent-ils aussi en zone rurale ?
Dans les zones rurales, il y a aussi un sujet d'accessibilité. Ces territoires sont notre point fort. Initiative France compte en moyenne deux antennes par département. En zone rurale, nous accompagnons le lancement de 4.000 entreprises chaque année, sur les 20.000 accompagnées au total.
Au printemps, vous déclariez à La Tribune vouloir « mettre le paquet sur le local et sur les jeunes, les femmes, les habitants des quartiers de la politique de la ville ». Comment ça se traduit ?
Nous sommes surtout présents auprès des habitants des QPV dans les régions Île-de-France et Provence-Alpes-Côte-d'Azur, mais ce n'est pas suffisant. Nous avons aujourd'hui pour objectif de passer de 1.400 à 3.000 entreprises créées et accompagnées chaque année dans les QPV d'ici à trois ans en France. Nous menons des actions comme ici, à Avignon, où un bus jaune, financé par les collectivités territoriales et la Bpifrance, se déplace dans les quartiers pour délivrer de l'information, susciter la curiosité. Nous mettons aussi en œuvre le programme In'cube, spécifique aux jeunes de moins de 30 ans avec la distribution gratuite d'une prime de 1.000 euros, pour faire cheminer leur projet, de l'idéation jusqu'au lancement. Il permet à des personnes qui se posent des questions de faire le chemin qui va les conduire à créer une entreprise. Il engage un parcours d'accompagnement renforcé pour des personnes éloignées de l'entreprenariat.
Que pensez-vous du nouveau report, le quatrième depuis janvier, du comité interministériel des villes annoncé par le gouvernement ?
Nous sommes très impatients que les décisions d'applications sortent. Le Président de la République a annoncé à Marseille un plan spécifique doté d'un « prêt spécial quartier ». C'était en juillet. Nous sommes mi-octobre. Il y a une grande impatience à ce que les modalités de tout ceci soient annoncées. Je ne peux pas être plus clair.
Comment, à ce propos, se passe le dialogue entre les collectivités territoriales, l'Etat, les administrations publiques et votre réseau. Comment articuler vos actions lorsque l'aspect politique vient s'y immiscer ?
La limite concerne plutôt les complications liées au grand nombre d'acteurs. Nous avons créé un collectif, nommé « Cap Créa », pour se repérer dans le maquis des aides et des institutions. Un guide de la création, préparé par la Bpifrance avec ce collectif, va d'ailleurs paraître dans quelques jours. Et une plateforme internet, le « Pass Créa », sera lancée pour se repérer dans tous les dispositifs d'aides.
Depuis 2015, le programme « Cité Lab » d'Initiative France intervient dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville. Le réseau Initiative Terres de Vaucluse utilise de son côté, depuis 2021, un camion financé par la Bpifrance et les collectivités territoriales pour « aller vers » les publics des quartiers populaires, représentant 60.000 personnes dans le département du Vaucluse, soit environ 12,5% de la population dans 22 quartiers, précise Sébastien Maggi, sous-préfet de l'arrondissement d'Avignon. Le « camion jaune », comme il est surnommé, suscite au moins la curiosité et « connecte les habitants », selon l'association. Pour Hisham Bourohi, directeur d'Initiative Terres de Vaucluse : « Nous sommes la brique manquante entre les publics dits « prioritaires », ou « invisibles » - et je n'aime pas ce terme - et les dispositifs ordinaires, pour la concrétisation de leurs projets. Je pense notamment aux femmes, ou encore aux jeunes sortis du système scolaire, mais aussi aux personnes à la retraite cherchant des compléments de revenu. Sans ce genre d'initiative, sans « aller vers » eux, directement dans les quartiers, près des écoles où l'on peut croiser des mères de famille, ou près des jeunes, nous ne pourrions pas les capter. » L'arrivée du bus a produit des premiers effets : « En un an, avec la venue du bus jaune, nous avons doublé notre afflux de public. Nous avons reçu 1.200 visites l'année dernière, pour un suivi, et aidé à la création de 200 entreprises ». L'antenne est présentée comme l'un des « exemples » du réseau en la matière. « Notre idée est aujourd'hui de formuler des propositions dans ce même sens », poursuit un cadre d'Initiative France. La dernière enquête réalisée auprès de 70 entrepreneurs exerçant des dans quartiers prioritaires montre que la moitié d'entre eux attend un meilleur accompagnement, devant les banques notamment, mais aussi pour s'intégrer aux écosystèmes économiques.Dans le Vaucluse, un bus pour « aller vers » les habitants des quartiers prioritaires

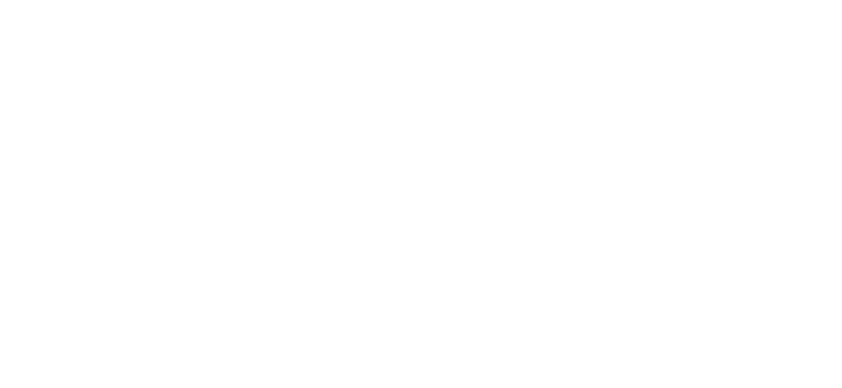

 « Territoires d'industrie » : un tiers de logements seront manquants pour répondre à la demande en Auvergne-Rhône-Alpes
« Territoires d'industrie » : un tiers de logements seront manquants pour répondre à la demande en Auvergne-Rhône-Alpes

Sujets les + commentés