
D'abord, contester la légitimité de l'information issue d'Internet simplement parce qu'elle est diffusée sur la toile, via les réseaux sociaux en particulier, revient à défendre la prééminence du papier sur l'écran. Plus encore, il s'agirait avec cet argument de ne reconnaître que les propos les plus légitimes et institutionnels, c'est à dire ceux des professionnels de la prise de parole dans l'espace public : journalistes, politiciens, syndicalistes...
Car, comme le rappelle le sociologue Dominique Cardon, les nouvelles voix de l'Internet "pluralisent et distribuent autrement les formes de la parole politique, en empruntant des langages et en habitant des espaces que la politique conventionnelle, bien souvent, ne sait pas reconnaître". Ce qui a amené Médiapart à titrer en janvier 2019, "Gilets jaunes" et médias, deux mondes qui se regardent sans se comprendre.
Une crise de la vérité
Ensuite, soyons honnêtes, dans certains projets de lutte contre cette fameuse infox, il s'agit de défendre notre vision du monde, notre appréciation des faits. Cette vision dichotomique, pétrie de certitudes, est-elle encore possible dans un monde connecté, une société de la connaissance et de l'information où la dynamique des réseaux sociaux produit "des essaims informationnels perméables, orientés par nos préférences et affinités", selon l'historien des cultures visuelles et Maître de conférences, André Gunthert.
Finalement, nous ne vivons pas une crise de la vérité, nous vivons une crise sur les modalités d'évaluation de la vérité. Avec l'avènement d'un monde en réseau, nous sommes face à une remise en question de la façon dont nous construisons le savoir.
Se représenter d'autres points de vue
Enfin, aujourd'hui, l'urgence face à l'information est de comprendre qu'elle est contextuellement et socialement construite et qu'il est fondamental d'aider les publics à se représenter d'autres visions du monde. Sans compter que notre rapport à l'information dépend aussi de nos compétences psychosociales, de notre capacité à nous intégrer et à trouver du sens dans le monde qui nous entoure. Concrètement, cela signifie se demander qui parle, qui est l'auteur, quelle est l'intention de son message et de comprendre ce que ce message nous fait vivre voire ressentir...
Peut-être devons-nous désormais imaginer que les projets d'éducation à l'information doivent nécessairement développer chez les jeunes — et les moins jeunes, redisons-le — une capacité de projection, d'empathie, pour comprendre d'autres modes de pensée, utiliser d'autres regards.
Cela nécessitera évidemment de recontextualiser l'information et de faire le point sur les intentions de ceux qui la produisent. En croisant ces différents points de vue, nous fabriquerons une pensée nuancée, complexe, articulant si cela nous est possible des idées parfois complémentaires et parfois contradictoires. Tout comme le sont évidemment les opinions dans une démocratie.

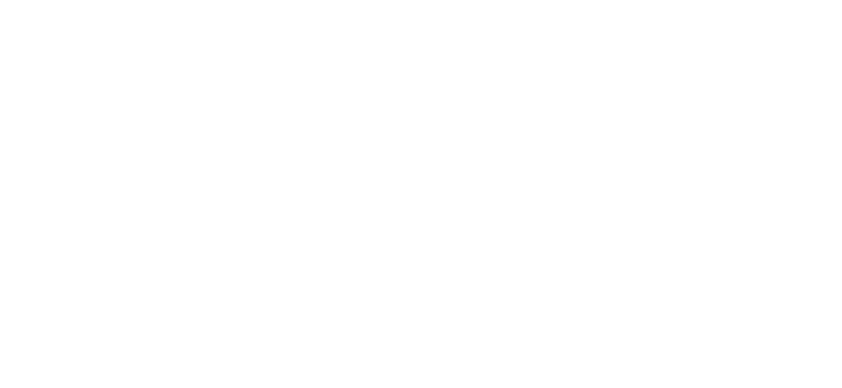


 A Chamonix, le chantier du téléphérique des Grands Montets incarne défi technique et environnemental
A Chamonix, le chantier du téléphérique des Grands Montets incarne défi technique et environnemental

Sujets les + commentés