
Depuis quelques mois, les retards de production au sein de certaines usines (automobile, électronique, etc) s'accumulent. A commencer par l'explosion des ventes de matériel informatique suite au confinement, mais également l'arrivée des téléphones 5G, la production en yoyo de l'automobile -repartie plus fort que prévu-, ou encore l'interdiction pour Huawei de se fournir en matériaux aux États-Unis et la bataille qui en a résulté avec la Chine... Cette série de facteurs a eu pour effet de provoquer une forte pression sur le marché des semi-conducteurs, et notamment sur la fourniture des composants.
À tel point que la dépendance envers des circuits de production, en grande partie hors des frontières de l'UE, a fini par inquiéter le gouvernement français. Récemment, le ministre des finances Bruno le Maire ainsi que le commissaire européen au marché intérieur Thierry Breton avaient d'ailleurs réaffirmé que la dépendance l'industrie automobile européenne vis-à-vis de l'Asie était « excessive » et « inacceptable ».
De quoi remettre une quinzaine de pays européens, dont la France et l'Allemagne, autour de la table, pour unir leurs forces et défendre leur souveraineté en matière de production, et leurs champions « locaux », tels que le franco-italien STMicroelectronics, le néerlandais NXP, l'allemand Infineon, mais aussi le Soitec. Car l'isérois -qui affiche une croissance de 30% cette année et annonce la création de 100 emplois en 2021- se situe à la naissance même de cette chaîne, fournissant une grande partie des substrats avancés entrant dans la composition des smartphones ou encore des antennes 5G.
En décembre, ces pays avaient annoncé la préparation d'une « alliance industrielle » européenne, visant à renforcer les capacités de production des puces les plus stratégiques. Avec à la clé, une enveloppe de 20 à 30 milliards d'euros qui demeurerait à trouver. Car l'industrie des semi-conducteurs se caractérise aussi par un fort appétit en matière d'investissements pour demeurer dans la course à l'innovation et à la miniaturisation des puces : dans ce domaine, jusqu'à une dizaine de milliards de dollars peuvent être nécessaires pour bâtir des fonderies de dernière génération.
C'est dans ce contexte, marqué par de forts enjeux stratégiques pour la filière, que la ministre chargée de l'Industrie, Agnès Pannier-Runacher, a choisi de se rendre dans la banlieue grenobloise, afin de rencontrer les acteurs du Comité stratégique de filière (CSF) des Industries Electroniques, chapeauté par Thierry Tingaud, par ailleurs président de STMicroelectronics France.
Objectif affiché : signer ensemble un avenant actualisant le contrat de filière, qui avait lui-même été annoncé il y a deux ans à quelques kilomètres de là, dans les locaux du groupe STMicroelectronics, à Crolles (38).
Une vingtaine de lauréats issus de la photonique et électronique
Selon les premiers éléments, le nouveau document qui sera présenté ce jeudi devrait proposer quant à lui de nouveaux axes structurants à la filière électronique française, et faire le lien avec « les enjeux prioritaires du plan France Relance », à travers l'octroi d'une nouvelle enveloppe qui pourrait venir renforcer la localisation des fabricants de cette industrie au sein de l'Hexagone.
En d'autres mots, amarrer cette filière stratégique à un plan plus global, qui se veut lui aussi décisif pour l'industrie française. Car avec ses 100 milliards d'euros répartis en un certain nombre de dispositifs, le plan de relance du gouvernement français insiste tout particulièrement sur la notion de relocalisation et de souveraineté industrielle.
L'Etat français devrait d'ailleurs en profiter pour dévoiler une nouvelle vague de 105 lauréats pour son appel à projets destinés à aider les « secteurs critiques », dont une vingtaine de nouveaux projets issus justement des secteurs de l'électronique et de la photonique.
Car le gouvernement le reconnaît : « La crise sanitaire a en effet rappelé le rôle stratégique de la filière électronique dans toutes ses composantes (fabricants, sous-traitants et distributeurs) et a mis en évidence le haut degré d'interdépendance de la chaîne de valeur électronique mondiale ».
Et ce n'est pas non plus un hasard si la ministre chargée de l'Industrie a choisi de revenir discuter de cet avenant, au sein même du berceau français de la microélectronique. Car dans un rayon de 20 kms de Grenoble, se trouvent en effet des leaders mondiaux du domaine, tels que STMicroelectronics, Soitec, Lynred, Teledyne, mais également des centres de recherche (CEA-Leti, Inria), ainsi que des pépites et startups (Aledia, Trixell, Pixalis, etc) et pôles de compétivité (Minalogic, etc).
Avec une spécialisation dans les substrats innovants et les imageurs notamment, destinés à alimenter un certain nombre d'applications sur le marché de l'électronique, l'écosystème grenoblois pèse lourd dans la balance puisqu'il rassemble près de 41.500 collaborateurs, sur un total de 100.000 acteurs de la fabrication électronique en France, pour une filière qui génère elle-même près de 15 milliards d'euros et jusqu'à 150.000 emplois indirects additionnels.
La suite du plan IPCEI dans le viseur ?
En mars 2019 déjà, le ministre de l'économie Bruno le Maire avait fait le déplacement à Crolles pour présenter le cœur de contrat de la filière électronique, qui était également assorti d'un grand plan d'investissement public-privé sur cinq ans, Nano 2022, qui doit justement se terminer d'ici 24 mois.
Ce « projet important d'intérêt européen commun » IPCEI (Important Project of Common European Interest), conclu entre quatre états européens (France, Allemagne, Royaume-Uni et Italie), visait déjà à soutenir les industriels de la microélectronique en leur permettant de consolider la fabrication européenne de certains composants électroniques stratégiques (composants à faible consommation énergétique, composants de puissance, capteurs intelligents, circuits en matériaux composites, etc).
En France, ce projet s'était traduit par une enveloppe de 6 milliards d'euros sur cinq ans, dont près d'un milliard d'aides publiques mobilisées à travers différents leviers (Europe, Etat, collectivités locales, etc). Les industriels de la filière, dont STMicroelectronics et Soitec, s'étaient quant à eux engagés à investir près de 5 milliards d'euros sur la même période « à travers des dépenses de travaux et d'investissements », mais aussi à créer ou maintenir près de 4.000 emplois directs et jusqu'à 8.000 emplois indirects.
« Nano2022, par sa dimension européenne liée à ce IPCEI, joue un rôle pionnier dans la constitution de cette future politique industrielle européenne que nous voulons promouvoir », indiquait déjà à l'époque Bruno Le Maire, rappelant que « ces industries, à la pointe des technologies, constituent le socle industriel indispensable pour l'ensemble des secteurs applicatifs, au premier rang desquels figurent l'automobile, l'aéronautique, le spatial et les objets connectés".
Deux ans plus tard, les besoins de la filière se confirment. Cette visite devrait donc marquer une occasion de réaliser également un point d'étape sur le programme Nano 2022, mais aussi d'envisager d'ores et déjà la suite.
Avec, à la clé, la volonté de construire et imaginer le plan « Nano 2027 » d'une filière "qui appelle continuellement d'importants investissements pour ne pas prendre de retard dans la course", rappellent régulièrement à l'unisson ses acteurs. Face à eux désormais, la réponse de l'Etat pourrait être éclairée d'une nouvelle manière par la crise sanitaire.

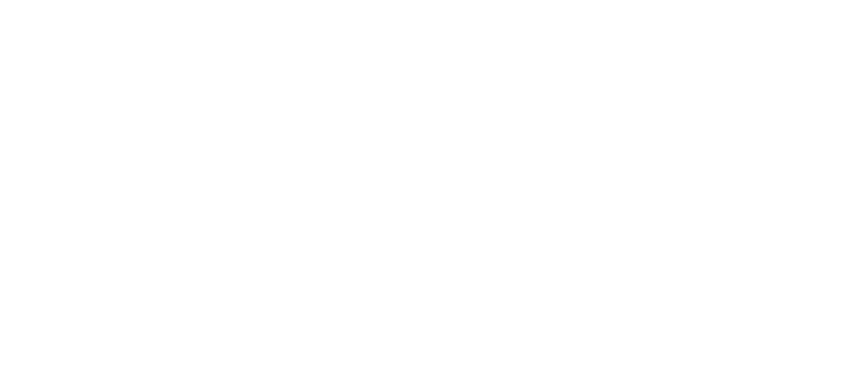

 Piles à combustible : après une levée de 64 millions, Inocel met le cap sur l’industrialisation à Belfort
Piles à combustible : après une levée de 64 millions, Inocel met le cap sur l’industrialisation à Belfort

Sujets les + commentés