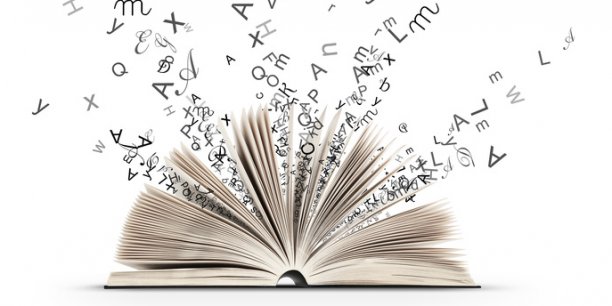
Article initialement publié le 9 février 2009.
"Le niveau de culture générale des candidats est tombé si bas que nous faisons désormais abstraction de ce sujet. Lorsque, par hasard, nous découvrons l'intérêt d'un postulant pour Dostoïevski ou la renaissance italienne, on ne le lâche pas ! Mais ce bonheur est si rare".
La confession, dépitée, de Monique Laurent, associée du cabinet de recrutement ADMA, est implacable. Des connaissances dans les humanités à l'appétence de lire ou la maîtrise orthographique, le constat de cette faillite ne connaît guère de contestateurs.
Cité dans l'enquête "Culture générale et management" produite en 2006 par l'Institut de l'Entreprise et les écoles de comme Audencia, Essec, et Inseec, Henri de Castries, président d'Axa, conclut au "déclin très net de la culture générale. Les lacunes en matière artistique, historique, religieuse, ou politique, sont considérables chez les moins de trente ans, y compris parfois chez les cadres de bon niveau". Fermez le ban.
Le symptôme est inquiétant. Le mal l'est-il autant ? Les participants à cette étude (outre Henri de Castries, Bertrand Collomb, Denis Kessler, Michel Pébereau, Louis Schweitzer et Yazid Sabeg, aux commandes alors respectivement de Lafarge, de la Scor, de BNP Paribas, de Renault, et de C&S Communication et Systèmes) partagent une préoccupation protéiforme, qui les atteint en leur qualité de citoyens - "c'est parce que les repères communs s'affaiblissent que l'intolérance et l'obscurantisme prospèrent"- mais aussi les dirigeants :
"À mesure qu'elles perdent la maîtrise de leurs propres références culturelles, les jeunes générations compromettent leur capacité à comprendre les autres cultures. Autrement dit, le maintien d'une forte cohérence interne est indissociable de l'ouverture internationale. Dès lors, la question de la culture générale ne peut rester à l'écart du champ des préoccupations managériales".
Le piège d'Internet
Car ces dernières subissent concrètement les effets du dépérissement. Exemple : le niveau déliquescent d'orthographe. De Dominique de Verneuil, associé chez ADMA, auquel un client a commandé une dictée pour évaluer des commerciaux aux comptes-rendus devenus "illisibles" par le nombre d'erreurs, à Christian Bérard, directeur de l'ESDES (école de management de l'Université catholique de Lyon), qui recueille des copies truffées de soixante fautes (!), c'est la désolation.
"On n'a pas le choix que de s'en accommoder. Un cadre de mon équipe ne sait pas distinguer et de est...", déplore, désabusé, Hervé Brochette, directeur industriel d'Actaris.
L'appauvrissement est généralisé à l'ensemble de l'écrit, et contamine syntaxe ou grammaire. Et donc la structuration même de l'expression. Absence de mise en scène et d'originalité, indigente du vocabulaire, recours au copier-coller... les présentations publiques et l'animation des réunions en sont affectées, le dialogue, le lien social et humain entre les collaborateurs en sont infectés. Autres particularismes constitutifs de la culture générale affadis ou compromis, ceux-là, par l'irruption d'Internet : le goût de l'effort, d'apprendre et d'approfondir.
Donnant à l'utilisateur l'illusion de "savoir" en seulement quelques clics sur la Toile, il épouse et consolide la logique dominante du zapping et de l'artifice. Celle aussi du morcellement et de l'éparpillement. L'école se substitue au tronc, l'instantané au durable. La culture du savoir immédiat, pré-marché est aussitôt balayé, marginalise celle des références à l'Histoire, celle du besogneux apprentissage. La passivité l'emporte, et est même légitimée par la profusion d'informations reçues. L'individu se contente de bribes, tout comme le lecteur des journaux survole les titres et les introductions.
Tout aussi grave, les supports Internet et télévisuel promeuvent au rang de référent culturel le phénomène de "peopolisation".
"Lorsque nous leur demandons ce qui les a marqués personnellement dans l'année écoulée, les candidats risquent bien de nous citer un livre, une exposition, un spectacle, ou un voyage, qu'un épisode médiatique. Même le Trivial poursuit propose désormais une version « célébrités »", regrette les deux associés d'ADMA.
Une fragmentation et une superficialité du savoir qu'ils opposent à l'utilité première de la culture générale : "l'art de savoir relier être eux des événements et des thèmes fondateurs". Nul besoin de s'étonner qu'autour de la machine à café ou à la cantine, les dernières frasques conjugales de Claire Chazal ou la couverture de VSD se substituent aux commentaires d'un film, d'un livre ou d'un enjeu politique.
Indolore à court-terme
Cette logique dominante de l'instantanéité des savoirs modèle peu à peu des mécanismes intellectuels eux aussi lézardés, affranchis de perspectives et de références, et donc nécessairement plus fugaces, futiles, fragiles.
Selon le postulat que la qualité d'une collectivité est égale à la somme des qualités de chaque individualité qui la compose, la paupérisation culturelle des entreprises et celle des attributs consubstantiels - créativité, curiosité, ouverture... - sont engagées. Sans effet sur le court-terme, mais sinistre au-delà. En effet, comment espérer construire une stratégie visionnaire sur cinq ans lorsque la réflexion qui la prépare est nue de référencements à l'Histoire, à des racines, à des connaissances parfois lointaines ?
Or, c'est bien parce que cette dégénérescence est sans effet sur l'immédiat que la plupart des entreprises négligent le sujet. Une incurie dans laquelle chaque partie se compromet. L'entreprise, qui a besoin d'être immédiatement efficace ; le directeur des ressources humaines, soucieux d'embaucher des compétences immédiatement opérationnelles ; enfin les consultants en recrutement, inféodés au donneur d'ordre et privilégiant l'endogamie à la variété des profils, la reproduction à la régénération sociale. Toutes ces parties vassalisées à une même obligation d'annihiler le risque et de contenter le court-terme, toutes complices malgré elles d'une résignation qu'elles fustigent pourtant avec force et sincérité, toutes confortées par l'impossibilité de sonder, de quantifier et donc de chiffrer les répercussions de cette déstructuration culturelle.
L'intérêt de recruter des profils singularisés par une forte culture générale devient alors d'autant moins évident que rien n'atteste d'un surplus de rentabilité pour l'entreprise, et qu'ils constituent des éléments "à risque". Cité dans le rapport d'études de l'Institut de l'Entreprise, Bertrand Collomb livre une synthèse limpide et honnête :
"Conscients du risque associé à une domination excessive des ingénieurs dans sa culture d'entreprise, Lafarge a eu à cœur de s'ouvrir à des profils atypiques, issus de formations en sciences humaines. Nous avons même procédé au recrutement d'un sociologue devenu ensuite directeur d'usine, et nous avons engagé des collaborations avec des sociologues et des philosophes (notamment Alain Etchegoyen). Pour autant, cette pratique demeure marginale. Le phénomène d'aversion au risque est puissant au sein des DRH : recruter un profil atypique est d'autant plus difficile que de telles les embauches apparaissent « gratuites » et qu'elles ne répondent à aucune nécessité clairement et immédiatement identifiable. À supposer qu'elles parviennent à surmonter ces réticences, les DRH doivent ensuite convaincre leurs « clients », les unités opérationnelles ; l'aversion au risque s'en trouve redoublée".
Sans valeur marchande
Un phénomène auquel n'est pas étranger l'état paroxystique de marchandisation de la société, au nom duquel tout ce qui n'est pas rentable immédiatement mais guère utile. La culture générale n'échappe pas à cette logique utilitariste et au culte omnipotent de profitabilité. Et les plus redoutables amalgames entretiennent la manipulation. Pour preuve, symbolique, la publicité de Samsung, invitant à "imaginer [son] votre téléviseur comme une œuvre d'art"...
Dès lors, si l'intérêt de consacrer quelques heures à Si c'est un homme de Primo Levi, d'arpenter le musée des Offices à Florence, d'ausculter la série Miserere de Rouault ou les photographies de Cartier-Bresson, de regarder La vie des autres, d'écouter Barbara ou un concerto pour violoncelle, de comprendre la révolution russe ou les massacres rwandais, n'est pas "transformé" en euros, il y a peu de chance que la culture générale constitue un critère, même mineur, de recrutement.
"Soyons honnêtes : c'est presque exclusivement sur les facultés de s'adapter et d'évoluer que nous arbitrons les embauches", reconnaît d'ailleurs Hervé Brochette.
Sur le diktat de cette rentabilité immédiate, de l'hyper spécialisation - des métiers, des compétences... -, de la nécessité de conjurer les risques, se juxtaposent le désintérêt pour toute connaissance périphérique, et la politique dominante du clonage de l'uniformisation. Au nom du principe de précaution est ainsi scellé le sort des profils atypiques. La servilité du corps social prime sur sa singularité et son indocilité.
Car en effet, comme le rappelle le directeur de l'IEP Lyon, Gilles Pollet, la culture générale façonne la faculté de "débattre, de critiquer, de contester, d'affirmer une opinion". Et donc celle d'être le grain de sable dans l'organisation bien huilée de l'entreprise. Les participants à l'enquête de l'Institut de l'Entreprise plébiscitent certes les managers "émergents " qui savent s'abstraire des considérations strictement liées au cœur de métier et des modes managériales véhiculées par la pensée dominante.
"La culture favorise clairement cette aptitude à la « déviance » », poursuivent-ils : le collaborateur cultivé est, mieux qu'un autre, à même de faire ce « pas de côté » qui lui permet, en raisonnant par analogie avec des situations très différentes dans le temps et dans l'espace,de parvenir à une compréhension plus fine des phénomènes complexes".
Mais du vœu à son exaucement, il y a un pas. Même un abîme.
"Or, c'est bien cette disposition à remettre en question, à bousculer, parfois à s'opposer, dont toutes les entreprises ont besoin pour (sur)vivre dans le concert de la mondialisation, corrobore Martine le Boulaire. L'entreprise qui gagne se distingue par sa capacité d'innover, de créer, de rebondir. Cette capacité n'est envisageable que si le corps social est lui-même composé de profils margino-séquants, c'est-à-dire non formatés, réactifs, indépendants, dérangeants, originaux. Parmi les éléments constitutifs de ce type de profil figure la culture générale, issue d'une confrontation aux mondes artistiques, littéraires, philosophiques, politiques... ".
Et la directrice d'entreprise & Personnel Lyon d'avouer son inquiétude face à l'exacerbation d'un phénomène "très franco-français" : l'ostracisme qui frappe le capital de connaissance, la généralisation d'un comportement amnésique à l'égard de l'Histoire, les racines, du patrimoine, apparenté à une forme de "totalitarisme", le "déni de la lignée" colporté par les managers.
"Toutes les entreprises ne sont pas concernées. Mais le risque existe et croît. Or il n'est pas possible de travailler à ce que l'on veut devenir si on nie son origine. Cela veut autant pour l'homme que pour l'entreprise".
Et dans cette dernière, le schisme peut prendre la forme inédite d'un fossé intergénérationnel et du rejet des seniors. Ceux-ci incarnent ce passé désuet et raillé, et ils portent un héritage de culture de moins en moins partagé et qui donc fracture la nature et la densité de leurs relations avec les générations qui leur succèdent.
La mondialisation, salvatrice
De riposter à la défaillance de la culture générale et de faire appel à des profils non normés est particulièrement prégnant chez les patrons d'entreprises internationales. En témoigne la charte Phénix, qui engage sept grandes sociétés à recruter des diplômes en lettres, sciences humaines et sociales de cinq universités parisiennes.
La mondialisation au secours de la connaissance non utilitaire ? "Absolument", affirme Rémi Boyer. Le secrétaire général de Mittal-Arcelor sait de quoi il parle. Cet exemple de profils atypiques fut le rapporteur de la commission Fauroux, et fut repéré au ministère de l'Education nationale, alors sous la responsabilité de François Bayrou, par Francis Mer. Le président d'Arcelor le propulsa à la direction d'usines puis des ressources humaines du géant de l'acier.
"Un groupe aussi mondial que le nôtre réclame deux compétences clés : celle d'avoir du recul sur l'entreprise, celle de questionner le système dans lequel elle évolue. Ces attributs résultent directement de la consistance de culture générale, laquelle permet par ailleurs aux cadres de naviguer d'un pays à l'autre doté d'une connaissance suffisante des situations politiques et culturelles locales".
Pour cette raison, les membres de la cellule fusions-acquisitions du conglomérat "possèdent tous" une copieuse culture générale ; ils pilotent des opérations internationales dont les conditions et l'issue ne résultent pas de données seulement financières, mais de particularismes non qualifiables qui exigent une maîtrise aiguë des spécificités culturelles, intellectuelles, comportementales, historiques, géopolitiques.
Cet homme, nostalgique des "convictions" par Francis Mer à "dialoguer sur la sociologie politique, à tester des idées, à confronter des opinions", applique la même logique iconoclaste qui dicta à son patron de le choisir, lui le titulaire d'un doctorat d'histoire novice en entreprise.
"Il rejetait les suiveurs et s'entourait de gens proactifs, lucides, critiques, capables de participer à l'anticipation de grands mouvements, aussi bien intellectuels que culturels. Moi-même porte soin à recruter des profils littéraires, notamment normaliens. Ils développent une forte capacité à intégrer des connaissances variées, à les appliquer à l'entreprise qu'ils bousculent grâce à leur approche non formatée. Ils comprennent les enjeux de la planète à partir de critères qu'on n'enseigne pas dans les écoles de commerce ou d'ingénieur même les plus prestigieuses. La nécessité des entreprises de savoir anticiper et lire un monde aux contours politiques, stratégiques, culturels de plus en plus complexes assure un bel avenir à ces personnalités littéraires".
Et le trublion d'opposer la logique française "sclérosante" des grandes écoles "cloisonnées, figées", qui produisent des futurs managers clonés, prostrés dans le périmètre de leur activité ou de leur métier, à celle des Anglo-saxons, capables,"eux", de nommer à la tête d'un groupe pharmaceutique le titulaire d'un Phd d'histoire médiévale. Effectivement inimaginable en France, où la presque totalité des hauts postes en entreprise est annexée par des dirigeants issus de l'aéropage des grandes écoles.
"Zéro"
Et c'est d'ailleurs sur l'enseignement que se concentre l'essentiel des anathèmes comme des exhortations.
"Le constat de l'affaiblissement du niveau culturel moyen des jeunes générations réclame une action énergique, qui ne peut être que du ressort de la formation initiale", insiste l'Institut de l'Entreprise.
D'abord bien sûr dans le secondaire, appelé à assurer la transmission d'un socle de connaissances fondamentales, à donner aux élèves de l'accès au savoir - apprendre à apprendre - et le goût de lire, à susciter envies et passions, à ouvrir au monde, aux humanités et à l'art, à préserver la valeur des matières le terrain. Lesquelles, délaissées par le marché de l'emploi, subissent négligence et mépris. Et sont même menacées d'extinction :
"La filière littéraire ne rassemble plus que 12 % des élèves au baccalauréat. Sous la barre des 10 % ; elle ne sera plus crédible et sera vouée à disparaître", prophétise le directeur de l'École normale supérieure Sciences humaines de Lyon Olivier Faron, fier des 70 débouchés annuels - contre 114 aujourd'hui - que produira prochainement la filière littéraire qu'il initie aux côtés de l'IEP Lyon et d'écoles de commerce.
Dans le secondaire, mais donc aussi dans le supérieur où, comme le déplore Jean-Damien Pô, de l'Institut de l'Entreprise, l'évaluation de la culture générale est "réduite à des QCM, comme pour le recrutement à la Commission européenne...". Volontiers vilipendées pour la monolithisme, la standardisation, l'utilitariste, l'hyperspécialisation de leurs cursus, ces l'établissements de commerce ou d'ingénieurs sont sommés par les participants de l'enquête "Culture générale et management" de "faire évoluer leur offre pédagogique en y renforçant la part des enseignements généraux (histoire, philosophie, anthropologie...). Ainsi répondront-elles le mieux aux besoins des entreprises".
Certains commencent de s'y employer. A EM Lyon, où l'on estime que le degré de sélectivité - 365 élèves reçus sur 5 400 candidats - constitue la garantie d'un bon niveau de culture générale - qui intervient dans 10% du total des coefficients d'admission-, des ateliers de développement personnel (théâtre, chant) sont institués en première année, et des associations d'élèves sont consacrées à la lecture ou aux articles plastiques. Cela n'empêche pas un membre de jury d'admission d'avoir récemment couronné une candidate d'un... zéro : "Elle rassemblait toutes les insuffisances que nous constatons de manière éparpillée, depuis une vingtaine d'années : aucun raisonnement, des idées morcelées, aucun référencement, une expérience désespérante... Tout de même, elle avait réussit à franchir le cap de l'admissibilité !".
A l'ESDES, cours de sociologie ou d'histoire de l'art, de revues de presse, enseignement des grands défis du monde contemporain, formation "humaine"... ont fait leur apparition.
"Nous devons tendre vers le modèle pédagogique anglo-saxon, encourage Christian Bérard. Au contraire de la France, où l'essentiel des connaissances à maîtriser pour l'examen final est fourni par les enseignants, en Grande-Bretagne ou aux États-Unis cette part tombe à 10 % ; les étudiants n'ont donc d'autre choix que d'apprendre par eux-mêmes, de lire, de se documenter, de constituer leur propre bagage culturel pour obtenir leur diplôme".
"C'est là, complète Jean-Damien Pô, que réside l'une des missions principales de l'enseignement supérieur : donner les clés de se cultiver".
Club Med
À ce chantier considérable, les entreprises doivent assumer leur part de contribution - ce dont elles estiment plutôt devoir être déchargées -, et introduire dans leurs critères de recrutement matière à valoriser cette culture générale. Difficile en effet de convaincre les établissements d'enseignement supérieur, dans le vivier desquelles elles font leur "marché", de donner consistance à la culture générale à l'égard de laquelle elles ne manifestent officiellement aucun intérêt, notamment lors des grands-messes de présentation ou des sessions de sélection...
Encore faut-il aussi que les jeunes eux-mêmes saisissent l'intérêt de la culture générale. "Mission complexe lorsque leurs objectifs de la vie se résument à gagner de l'argent est à buller au Club Med...", fulmine Olivier Faron. Un "idéal"que Dominique de Verneuil met en miroir de celui qu'il connut jeune.
"On rêvait alors d'Europe, on était tiers-mondiste, on partait sac au dos à la découverte du monde. Or ce monde s'est rapproché de nous, perdant une part de son mystère, surtout donnant l'impression, illusion, que l'on sait tout de lui après un reportage à la télévision ou une recherche sur Internet".
Une désacralisation aux effets vertueux. Mais aussi pernicieux. "Car c'est la capacité même d'être curieux qui en est affaiblie". Et le consultant de métaphoriser sur les plantes hydroponiques : "Un peu d'eau, et elles poussent vite, impressionnent. Mais elles ne montent jamais haut et vivent peu longtemps. La société était cette image : elle préfère des plantes passagères de belle apparence à de hauts arbres centenaires et solides. Et à l'égard de la culture elle recourt à la même logique".
Mais bien davantage que l'enseignement et l'entreprise, le ferment essentiel a pour cadre la famille, où germe et prospère - ou non - le goût de se cultiver. La qualité de la socialisation, la densité de l'empreinte atavique, l'envergure de l'éducation reçue, conditionnent en premier lieu le dimensionnement de culture générale. Fait alors irruption sa pensée perverse, dénoncée par Yazid Sabeg et Louis Schweitzer.
Dans cette culture générale, le premier repère dès les concours d'entrée aux grandes écoles "l'instrument du filtre, de la sélection pour l'accès aux filières les plus prestigieuses. Son enseignement en classes préparatoires joue un rôle aberrant, et lors des concours, censés garantir l'équité et le respect du mérite, ses épreuves organisent une forme certaine de calcification sociale".
Le président de la Halde (Haute Autorité de la Lutte contre les Discriminations et pour l'Égalité) considère de son côté qu'elle "exerce un rôle très puissant de discrimination sociale (...), et son absence ne doit pas être de nature à compromettre la réussite professionnelle d'un collaborateur dans l'entreprise".
"Je l'entends bien, réplique Hervé Brochette. Mais qu'on me donne les raisons et les moyens de ne pas bloquer à un certain niveau la progression de carrière d'un cadre incapable de produire un écrit sans faute ou de répondre à un client qui lui parle de littérature. Il faut être réaliste.
Urgence
Culture générale pour le meilleur. Et donc pour le pire. "Or, il y a urgence à réhabiliter", rappelle Paul-André Faure, fondateur du cabinet de recrutement Innoé. D'autant plus qu'elle déserte les élites.
"Leur niveau est affligeant. Aujourd'hui, la culture des médecins se résume à lire L'Equipe et à jouer au golf. C'est l'avènement de la culture superfétatoire ; on lit son Goncourt sur une plage de Saint-Tropez", déplore Olivier Faron.
Un constat qui gangrène jusqu'au sommet de l'Etat. Pour démonstration le récent débat présidentiel - au cours duquel le thème de la culture fut d'ailleurs muselé, méprisé - ; il opposa un candidate socialiste aux références anémiques et qui, de son propre aveu, "ne lit pas", à un vainqueur dont "l'image culturelle" - sans qu'on sache si elle correspond à la réalité ou à une manœuvre électoraliste - a pour visages ceux de Johnny Halliday, de Didier Barbelivien, du scientologue Tom Cruise, de Jean-Marie Bigard ou d'Enrico Macias...
"Plus jamais nous n'aurons de Président de la République homme ou femme de culture. Le dernier a été François Mitterrand. Le mouvement est irréversible", pronostique Olivier Faron.
La gestion des pouvoirs - politiques comme industriels - par une génération moins cultivée promet à cette culture d'occulter une place plus mineure. Déjà, nombre d'enseignants, y compris de prestigieux établissements supérieurs, commencent d'abdiquer face à des élèves qui s'estiment « incapables » de lire une livre dans l'année...
Un renoncement, une démission symptomatique d'une déliquescence qui empoisonne jusqu'à la capacité même d'être porteur d'idéaux, d'utopies et de révoltes.
"Mais tout « fout-il » vraiment le camp ?, tempère Gilles Pollet. Les associations de cinéma, de lecture, en arts portées par des étudiants se développent. Et il est temps d'accepter que la culture ne se réduise pas à Wagner et à Rodin. Elle embrasse son époque, et celle-ci connaît des bouleversements qu'elle doit nécessairement inclure dans son contenu. Ou alors on fait le choix d'une culture ségrégée, réservée à une élite, coupée du monde. Au dépérissement de la culture, il faut plutôt objecter son perpétuel renouvellement. La langue évolue, se transforme. Tant mieux".
Et le directeur de l'IEP de blâmer cette culture générale "d'avant, soi-disant idéale" mais si idéologisée qu'elle frappait de cécité des laudateurs des régimes chinois ou soviétiques. S'y est substitué un contenu davantage désabusé et cynique, appauvri d'utopie créatrice, mais aussi plus lucide. Et pragmatique. De ce même pragmatisme au nom duquel Olivier Faron préconise de s'appuyer pour corréler la culture générale des jeunes à leurs centres d'intérêt.
"Partons de ce qu'ils veulent entendre, amenons-les à des sujets qui leur donnent envie de poser des questions, de chercher des réponses, de nourrir leur appétit de connaissances. Ils forment la génération de l'humanitaire, de l'antiracisme ? Et bien, emmenons-les à Auschwitz".
Primo Levi serait fier. Et l'utilité de son œuvre universelle. Y compris pour les managers.



 Semi-conducteurs : Soitec suspend son projet d'extension de l'usine de Bernin en Isère
Semi-conducteurs : Soitec suspend son projet d'extension de l'usine de Bernin en Isère

Sujets les + commentés