
Main dans la main, le CHU de Saint-Etienne, l'Université Jean Monnet et la startup BioSpeedia progressent très rapidement sur divers sujets de recherche en lien avec le Covid-19. BioSpeedia, une spin-off de l'Institut Pasteur créée en 2011, a son siège social à Paris mais une partie importante de ses activités de recherche est installée à Saint-Etienne, dans les murs du Groupe immunité des Muqueuses et Agents pathogènes (GIMAP), le laboratoire universitaire de la Faculté de Médecine. La jeune pousse est spécialisée dans le diagnostic rapide pour les infections bactériennes respiratoires et la méningite bactérienne.
Des tests de sérologie rapides prêts pour la commercialisation
BioSpeedia a développé un test sérologique rapide pour le Covid19, dont l'efficacité vient d'être évaluée par le CHU de Saint-Etienne avec des taux de concordance voisins de 100%.
"Il s'agit de tests rapides, qui doivent être réalisés par des professionnels de santé mais très simples d'utilisation. Ils permettent de détecter, sur deux lignes différentes, les immunoglobulines M qui apparaissent au début de l'infection, et les immunoglobulines G qui, elles, font leur apparition plusieurs semaines après la contamination", explique Yves Germani, directeur scientifique de BioSpeedia.
Même si aucune certitude n'est encore acquise dans le corps médical quant à la durée de protection offerte par les anticorps développés par les patients ayant contracté le Covid-19, ces tests sérologiques seront très utiles lors du déconfinement et dans le suivi de cette pandémie.
Les tests BioSpeedia peuvent désormais être mis sur le marché européen puisqu'ils viennent d'être marqués CE conformément à la réglementation en cours.
3 millions de tests par mois
"Nous sommes fortement sollicités et nous disposons des capacités de production. Nous avons pris nos dispositions pour augmenter ces dernières, tout en respectant nos exigences de qualité", souligne Evelyne Bégaud, ex-chercheuse de l'Institut Pasteur, comme Yves Germani, et cofondatrice de la startup.
La fabrication est lancée avec un objectif de trois millions de tests fabriqués par mois. Une partie significative de la production des réactifs sera réalisée à Saint-Etienne (notamment la culture du virus, dans le laboratoire P3 de l'Université). Seule la plasturgie est sous-traitée à l'étranger.
La startup envisage de compléter sa démarche pour proposer des auto-tests accessibles aux particuliers.
En parallèle, et toujours en partenariat avec le GIMAP et le CHU de Saint-Etienne, BioSpeedia travaille à la mise au point d'un test rapide de diagnostic direct.
"Ce test innovant, réalisé selon une technique très pointue, pourra être fait au chevet du patient. Il coûtera deux fois moins cher que le test PCR. Il sera moins sensible mais il permettra d'économiser les tests PCR pour tous ceux dont notre test affichera la positivité. Pour les autres, il faudra compléter avec la RT-PCR afin d'éliminer les faux négatifs", poursuit Yves Germani.
Ces tests devraient entrer dans les prochains jours dans leur dernière phase d'évaluation avant leur mise sur le marché.
Le coup d'après
La startup, qui navigue entre Paris et Saint-Etienne, veut également apporter sa contribution à un futur vaccin. Elle a été sollicitée par un grand groupe pharmaceutique (dont le nom reste confidentiel) pour mettre à disposition ses capacités à expliquer les réactions immunitaires.
"Nous avons monté un consortium sur ce sujet avec une entreprise stéphanoise et une entreprise lyonnaise. Saint-Etienne apporte la clinique et la physiologie. Lyon, investigue le volet virologique et BioSpeedia permet l'acquisition des informations au niveau des sérums des patients et des sujets vaccinés. Nous devons tous avancer sur le vaccin car sans lui, nous ne réussirons pas à sortir de cette situation de crise", poursuit-il.
BioSpeedia recrutera dans les prochaines semaines des scientifiques, des techniciens, et complétera son management.
Etude sur les cofacteurs à l'université Jean Monnet
Au sein de cette même équipe du Gimap, mobilisée aux côtés de BioSpeedia, un autre travail est mené en lien avec le nouveau coronavirus.
"Il s'agit d'une recherche plus fondamentale", explique Stéphane Riou, vice-président de l'Université en charge de la Recherche.
Celle-ci porte sur les cofacteurs déclenchant des complications graves, en lien avec le terrain viral et bactériologique des patients. Une recherche co-financée par l'Agence Nationale de Santé. Une première enveloppe de 34 000 euros a d'ores et déjà été actée mais elle pourrait atteindre plus de 100 000 euros.
L'Université a décidé, en complément, de renforcer les moyens de ce laboratoire en investissant 300 000 euros dans un microscope Confocale. Celui-ci utilise différentes sources laser et peut être couplé à un ordinateur. Il permet d'étudier du matériel fixé mais aussi des cellules ou des tissus vivants avec une résolution intéressante.
"Cet instrument va permettre de gagner beaucoup de temps pour identifier les mécanismes de synergie entre le SARS-coV-2 et certaines bactéries ou d'autres virus dans le cadre des co-infections qui peuvent être observées dans cette pathologie et qui semblent être un facteur de gravité", explique Thomas Bourlet, du Gimap.
"Depuis deux ans, nous allouons un budget d'investissement d'un million d'euros annuel à nos laboratoires afin de maintenir un équipement de pointe", abonde Stéphane Riou.
Fondé dans les années 90, le GIMAP accueille une équipe d'une dizaine de chercheurs. A l'occasion du prochain contrat quinquennal, il devrait rejoindre le Centre International de Recherche en Infectiologie (CIRI).

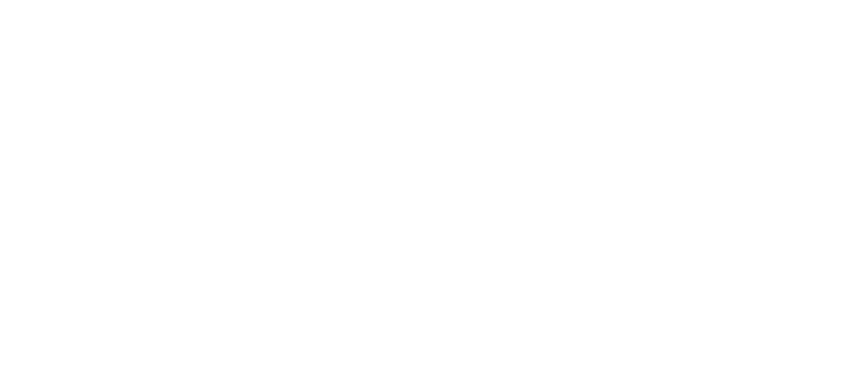

 Piles à combustible : après une levée de 64 millions, Inocel met le cap sur l’industrialisation à Belfort
Piles à combustible : après une levée de 64 millions, Inocel met le cap sur l’industrialisation à Belfort

Sujets les + commentés